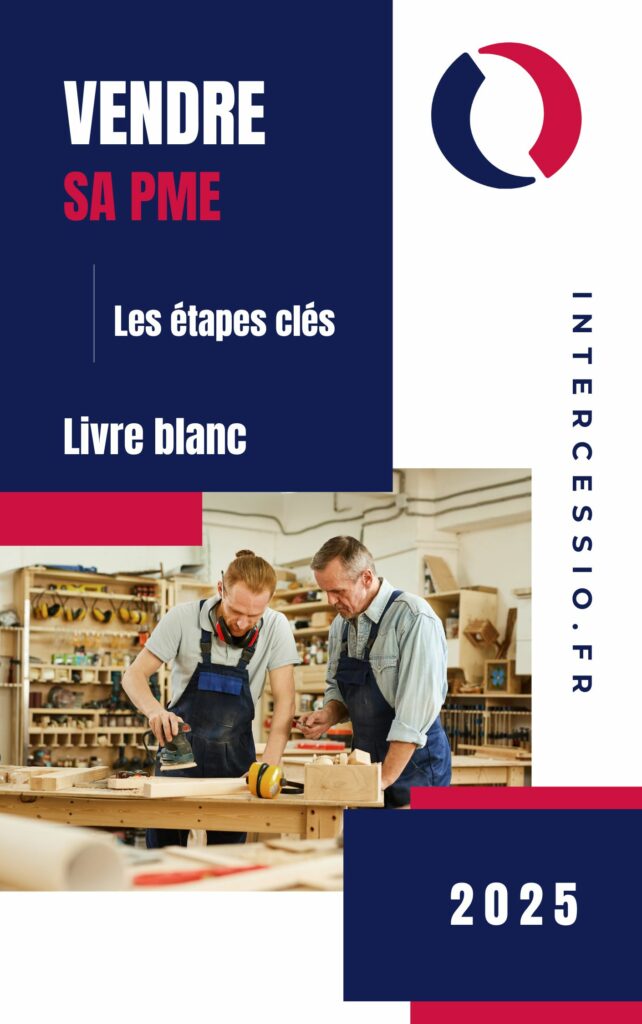LBO – Trésorerie de la cible : comment l’utiliser ?
Pourquoi la trésorerie devient un levier incontournable des montage de reprise
Dans un contexte économique où le coût de l’endettement grimpe et où les banques se montrent plus frileuses, utiliser la trésorerie de la cible dans les LBO est redevenu une stratégie prisée par de nombreux dirigeants et investisseurs avertis. Cet outil, longtemps réservé aux fonds d’investissement spécialisés, séduit désormais les dirigeants de PME et ETI qui souhaitent reprendre ou transmettre leur entreprise tout en optimisant le montage financier.
Concrètement, la trésorerie disponible au bilan de la société cible — souvent accumulée grâce à une gestion prudente ou un modèle générant beaucoup de cash-flow — peut venir réduire la part de dette bancaire nécessaire pour financer l’acquisition. Résultat : un montage plus léger, un risque bancaire mieux maîtrisé et un effet de levier interne qui maximise le rendement des fonds propres investis.
Aujourd’hui, plus de 30 % des LBO en Europe intègrent directement une part de trésorerie cible dans leur plan de financement, selon un rapport de Deloitte (2024). Cette proportion tend même à croître dans les secteurs où les entreprises génèrent un excédent de trésorerie structurel : services BtoB, numérique, santé.
En France, les dirigeants redécouvrent cette approche, d’autant plus que l’environnement fiscal et réglementaire reste favorable, sous réserve de respecter certaines limites strictes que nous détaillerons plus loin.
Des tensions sur le crédit et recours aux ressources internes des cibles
Depuis 2022, les taux d’intérêt ont fortement augmenté en Europe, renchérissant le coût de la dette bancaire pour financer un LBO. Pour de nombreux dirigeants repreneurs, cette hausse a eu un double effet : complexifier l’accès au crédit et réduire la capacité d’endettement tout en augmentant le poids des intérêts sur la rentabilité future de l’opération.
Dans ce contexte, la trésorerie interne devient un “levier caché” extrêmement puissant. Elle permet de :
- Réduire la dette bancaire nécessaire, donc de rassurer les prêteurs.
- Diminuer le ratio dette/EBITDA, ce qui améliore la perception du risque pour les actionnaires minoritaires ou co-investisseurs.
- Protéger la capacité de financement post-rachat, en évitant de trop grever l’entreprise cible de charges d’intérêts excessives.
Par exemple, une PME générant 1 million d’euros de trésorerie excédentaire peut affecter une partie de ce montant — souvent entre 40 et 70 % — au financement du rachat, tout en conservant une réserve suffisante pour couvrir son besoin en fonds de roulement (BFR).
Dans un climat économique plus incertain, cette approche séduit de plus en plus de dirigeants pragmatiques, qui préfèrent maîtriser leur montage plutôt que dépendre exclusivement des banques ou de la dette mezzanine, souvent plus coûteuse.
Mécanique d’un LBO : où intervient la trésorerie cible ?
Rappel du schéma classique d’un LBO
Un LBO (Leverage Buy Out) repose sur un principe simple : racheter une entreprise en grande partie grâce à de la dette, remboursée par les futurs flux de trésorerie dégagés par la cible elle-même.
Classiquement, un montage LBO s’appuie sur trois blocs principaux :
1️⃣ Les fonds propres, apportés par le repreneur (dirigeant, fonds d’investissement ou management).
2️⃣ La dette bancaire senior, octroyée par les banques commerciales.
3️⃣ Éventuellement une dette mezzanine, apportée par des investisseurs spécialisés.
Dans ce schéma, la trésorerie de la cible est parfois considérée comme “passive”, servant surtout de matelas de sécurité. Mais depuis quelques années, elle est de plus en plus intégrée comme une ressource active, qui vient directement réduire le montant de la dette externe.
Ainsi, au lieu de lever 5 millions d’euros auprès des banques pour racheter une entreprise valorisée 6 millions, le repreneur peut mobiliser 1 million de trésorerie excédentaire, ne lever que 4 millions de dette et limiter son exposition aux intérêts.
Intégrer la trésorerie dans le plan de financement
En pratique, la trésorerie peut être utilisée dès la structuration de l’opération, sous certaines conditions :
- Une partie est souvent distribuée sous forme de dividende exceptionnel pré-LBO ou dans le cadre d’un rachat de titres.
- Elle peut également être affectée à un remboursement anticipé de dette intra-groupe.
- Dans certains montages plus sophistiqués, elle alimente une holding qui rachète les parts, tout en maintenant un niveau de liquidité suffisant pour l’activité courante.
⚠️ Attention : tout prélèvement doit être justifié économiquement et sécurisé juridiquement (respect de la distribution des dividendes, respect du Code de commerce sur les conventions réglementées, absence d’abus de biens sociaux).
Les banques, de leur côté, exigent généralement une due diligence précise sur le niveau réel de trésorerie mobilisable, afin d’éviter de mettre en péril l’exploitation post-rachat.
Chiffres clés du marché des LBO en 2025
Nombre d’opérations et volumes levés
Le marché des LBO reste dynamique en Europe et particulièrement en France, malgré un contexte économique plus tendu. Selon PitchBook et Invest Europe, près de 1 400 opérations de LBO ont été conclues en Europe en 2024, pour un volume global estimé à plus de 320 milliards d’euros. En France, on estime à environ 280 opérations pour un montant cumulé de 45 milliards d’euros, ce qui place l’Hexagone dans le top 3 européen.
La taille moyenne des deals varie fortement selon le segment :
- Pour les PME et ETI, la valorisation moyenne oscille entre 5 et 50 millions d’euros,
- Les deals mid-cap tournent autour de 100 à 250 millions,
- Tandis que les gros LBO dépassent régulièrement le milliard d’euros.
Depuis deux ans, on constate une légère baisse du nombre de méga-deals, mais une stabilité, voire une hausse, des opérations de petite et moyenne taille. Les dirigeants de PME familiales et les managers repreneurs profitent de cette fenêtre pour structurer des montages plus souples et mieux adaptés au contexte bancaire actuel.
Poids moyen de la trésorerie dans les deals récents
Dans plus de 30 % des opérations mid-cap, la trésorerie disponible de la cible est désormais mobilisée comme ressource partielle de financement. Cette pratique est particulièrement répandue dans les secteurs où les entreprises génèrent une forte capacité d’autofinancement : services numériques, ESN, cabinets de conseil, santé, industries de niche à forte marge.
En moyenne, les montages actuels incluent entre 10 et 25 % du prix d’acquisition financés par la trésorerie de la cible. Cela permet de réduire le levier bancaire sans pénaliser la liquidité de l’entreprise, à condition de bien dimensionner le besoin en fonds de roulement (BFR) et les investissements futurs.
Par exemple, une PME dans le conseil IT valorisée 10 millions d’euros peut disposer de 1,5 million de trésorerie nette mobilisable. Ce montant vient en déduction de la dette bancaire à lever, sécurisant ainsi la transaction pour les prêteurs, tout en offrant au dirigeant repreneur une marge de manœuvre financière pour piloter sereinement la croissance post-rachat.
Les études de marché confirment que cette approche séduit : selon KPMG, plus de 45 % des dirigeants de PME envisageant une transmission d’ici 3 ans considèrent l’utilisation de la trésorerie comme un élément clé de leur stratégie de financement. Cette tendance est également favorisée par un encadrement réglementaire encore relativement souple, même si certains contrôles fiscaux récents rappellent l’importance de respecter strictement la loi.
Avantages stratégiques et limites à connaître pour mobiliser la trésorerie
Maximiser l’effet de levier interne
Le principal avantage d’utiliser la trésorerie de la cible dans un LBO est bien sûr de renforcer l’effet de levier sans alourdir la dette bancaire. Concrètement, cela signifie que l’acheteur finance une part du prix avec de l’argent qui dort déjà dans l’entreprise, plutôt que de mobiliser des capitaux externes. Résultat : le rendement des fonds propres investis (Return On Equity) est mécaniquement amélioré.
C’est particulièrement intéressant pour les managers repreneurs ou les actionnaires familiaux qui veulent limiter la dilution de leur participation, tout en gardant la maîtrise du capital. Pour un investisseur financier, c’est aussi un moyen de sécuriser une rentabilité plus élevée, en optimisant le rapport entre dette et capitaux propres.
Un autre atout : la capacité de remboursement est préservée. La trésorerie interne ne génère pas d’intérêts bancaires supplémentaires, ce qui réduit la charge financière sur le cash-flow futur. Cela peut faire la différence dans une période où les taux dépassent parfois 6 à 7 % pour les PME.
Risques juridiques et fiscaux
Cependant, cette pratique n’est pas sans limites. Le premier risque concerne le respect du Code de commerce. Il est strictement interdit de vider la trésorerie de l’entreprise au point de mettre en péril son exploitation. Tout prélèvement doit être réalisé dans le cadre légal d’une distribution de dividendes ou d’un rachat de titres, validé par l’assemblée générale des actionnaires.
Sur le plan fiscal, l’administration peut requalifier certaines distributions excessives en abus de biens sociaux ou en avantage indirect, avec à la clé des redressements significatifs et des sanctions pénales possibles pour les dirigeants. Un contrôle fiscal peut ainsi porter sur la sincérité du bilan, le niveau de trésorerie réellement mobilisable et l’adéquation avec le BFR de l’entreprise.
Enfin, mal dimensionner l’utilisation de la trésorerie peut fragiliser la société cible : un BFR mal évalué, des créances clients non recouvrées ou des imprévus conjoncturels peuvent assécher la trésorerie et générer une crise de liquidité.
Les repreneurs doivent donc procéder à une due diligence approfondie, anticiper les besoins à 12 ou 18 mois et sécuriser une ligne de crédit revolving en cas de besoin de trésorerie complémentaire.
Bonnes pratiques pour les dirigeants
Vérifications et audit de trésorerie
Avant tout montage, le dirigeant repreneur doit commander un audit de trésorerie détaillé pour s’assurer du montant réellement disponible. Trop souvent, une trésorerie affichée au bilan peut inclure des flux destinés au paiement de dettes fournisseurs, de charges sociales ou d’acomptes fiscaux à court terme. Un audit financier rigoureux, réalisé par un expert-comptable indépendant ou un cabinet spécialisé en transaction services, est indispensable pour évaluer la trésorerie réellement mobilisable.
Il est aussi crucial de vérifier la structure de la trésorerie : une partie peut être immobilisée sous forme de dépôts bloqués, de cautionnements ou d’engagements spécifiques. Ces éléments doivent être isolés pour éviter toute mauvaise surprise.
Structurer sans fragiliser la cible
Un autre point clé : ne jamais prélever toute la trésorerie disponible. Il faut conserver une réserve minimale pour couvrir le besoin en fonds de roulement (BFR) et faire face aux imprévus : retard client, hausse des stocks, variation saisonnière. En général, les professionnels recommandent de garder au minimum 2 à 3 mois de charges fixes ou 15 à 20 % du chiffre d’affaires annuel en liquidités après l’opération.
Ensuite, le dirigeant doit anticiper la validation juridique : toute distribution doit être approuvée par l’assemblée générale ordinaire, inscrite dans les statuts et conforme au droit des sociétés. Une convention réglementée peut être nécessaire pour sécuriser l’opération vis-à-vis des actionnaires minoritaires ou de l’administration fiscale.
Enfin, prévoir une communication transparente avec les banques est fondamental. La plupart des établissements de crédit imposent un covenant financier encadrant l’utilisation de la trésorerie. Mieux vaut négocier ces clauses en amont pour éviter toute clause de remboursement anticipé en cas de dépassement.
Bien utilisée, la trésorerie de la cible devient alors un levier puissant et sécurisé pour réduire la dette bancaire, optimiser les fonds propres investis et maximiser la rentabilité d’un LBO.
FAQ sur l’utilisation de la trésorerie cible
Est-ce légal ?
Oui, utiliser la trésorerie de la cible dans un LBO est parfaitement légal, à condition de respecter le cadre juridique prévu par le Code de commerce. L’opération doit être réalisée dans le strict respect des règles sur la distribution de dividendes ou sur le remboursement des comptes courants d’associés. Toute distribution exceptionnelle doit être validée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et respecter les conditions de distribution de bénéfices disponibles. En cas de non-respect, le dirigeant s’expose à une requalification en abus de biens sociaux, passible de sanctions pénales et financières.
Jusqu’où peut-on aller ?
Il n’existe pas de seuil légal unique, mais la pratique recommande de ne jamais ponctionner la totalité de la trésorerie. La bonne approche consiste à conserver un « matelas » pour couvrir les dépenses courantes, le BFR, et anticiper les aléas. La plupart des experts fixent un seuil prudent à 60-70 % de la trésorerie nette disponible, le reste devant rester dans les comptes pour sécuriser l’exploitation post-rachat. Bien entendu, ce seuil varie selon le secteur, la saisonnalité et le cycle d’exploitation.
Quels contrôles mettre en place ?
Pour éviter tout risque de dérive, le dirigeant doit impérativement organiser un audit financier détaillé, souvent confié à un cabinet indépendant. Un suivi mensuel post-opération est aussi fortement conseillé pour vérifier que le niveau de liquidités reste cohérent avec le plan d’affaires. Côté prêteurs, les banques exigent souvent des covenants financiers (ratios de liquidité, seuil de trésorerie minimum) pour contrôler l’équilibre financier de l’entreprise cible. Respecter ces engagements est essentiel pour maintenir la confiance du pool bancaire.
Quels secteurs sont les plus adaptés ?
Les secteurs où l’utilisation de la trésorerie cible est la plus fréquente sont ceux à forte génération de cash-flow et à cycles d’exploitation courts : services BtoB récurrents (ESN, cabinets de conseil), industrie légère à forte marge, santé et dispositifs médicaux, et certaines activités digitales. En revanche, dans les secteurs cycliques ou capitalistiques comme l’industrie lourde ou la construction, la marge de manœuvre est souvent plus limitée, car le besoin en trésorerie pour financer l’activité reste élevé.
Quel impact sur la valorisation de la cible ?
La trésorerie nette mobilisable est généralement traitée séparément dans la valorisation d’une entreprise. Dans un LBO, le prix d’acquisition est souvent ajusté en valeur d’entreprise (VE), auquel on ajoute ou retranche la trésorerie nette après ajustement. Plus la trésorerie est élevée, plus elle peut venir réduire le besoin de dette ou renforcer le prix payé aux vendeurs. Toutefois, il ne faut pas confondre trésorerie structurelle (liquidité réellement excédentaire) et trésorerie de fonctionnement (indispensable pour faire tourner l’activité).
Peut-on mixer plusieurs sources de financement ?
Absolument. C’est même recommandé pour sécuriser un LBO équilibré. La trésorerie de la cible vient souvent compléter une dette senior bancaire, une éventuelle dette mezzanine (subordonnée) et un apport en fonds propres. Certains montages intègrent aussi des mécanismes comme le vendor loan (crédit-vendeur) ou l’émission d’obligations convertibles pour optimiser la structure de capital. Le dirigeant doit arbitrer entre effet de levier maximum, coût global du capital et capacité de remboursement future.
Conclusion : faire de la trésorerie un atout gagnant pour votre LBO
Dans un contexte économique marqué par la remontée des taux et des exigences bancaires renforcées, utiliser la trésorerie de la cible dans les LBO devient un outil stratégique majeur pour tout dirigeant souhaitant racheter ou transmettre une entreprise. Bien maîtrisée, cette approche permet de réduire la dette externe, de sécuriser le montage financier et de maximiser la rentabilité des fonds propres investis.
Cependant, ce levier doit être manié avec rigueur et transparence. Vérifications juridiques, audits financiers, validation des organes de gouvernance et anticipation des besoins futurs sont autant de bonnes pratiques incontournables pour éviter toute mauvaise surprise. Bien entouré de conseils spécialisés (avocat, expert-comptable, cabinet de M&A), le dirigeant peut transformer cette trésorerie « qui dort » en ressource active pour financer son projet de croissance ou de transmission.
Enfin, le succès d’un LBO ne repose jamais sur un seul levier. Il résulte d’un équilibre subtil entre apport en capital, dette bien calibrée et trésorerie intelligemment mobilisée. Avec une stratégie claire et des outils financiers bien maîtrisés, la trésorerie de la cible devient une arme redoutable pour réussir un LBO dans les meilleures conditions.